SINJAR, un film de Anna Bofarull
Article de Véronique Gille
Durée: 127 min.
Année: 2022
Pays: España
Réalisation: Anna Bofarull
Scénario: Anna Bofarull
Musique: Gerard Pastor
Photographie: Lara Vilanova
Interprétation: Nora Navas, Halima Ilter, Iman Ido Koro, Guim Puig, Mouafaq Rushdie, Luisa Gavasa, Franz Harram, Àlex Casanovas, Hennan Bereket, Samia Naif, Mercè Rovira
Genre: Drama.
Sinjar est un film basique, un film d’apprentissage, une tentative de film courageuse et honnête. Il narre le destin de trois femmes qui ne se connaissent pas, d’où une trame qui est décousue dans son début. Cependant, le thème qui peut les unir est fort : l’intégrisme religieux, thème qui se renforce peu à peu au cours du film. La religion sous sa forme intolérante et implacable viole les corps, viole les esprits, c’est pourquoi le spectateur ne se surprendra pas dès les premières séquences de l’association faite entre islamisme radical et violence. Une prière, un viol. La prière du maître, le viol de l’esclave Hadia.



Certes, c’est une situation désormais reprise dans de nombreux films et documentaires depuis les années 2000 (Syngué Sabour, La pierre de patience 2012, Wadjda 2012, Mustang 2015, Timbuktu 2014, Esclaves de DAECH – Le destin des femmes yézidies 2018, No man’s land 2020…). La vision de la cinéaste sur le monde musulman est noire –la plupart des séquences sont tournées dans l’obscurité- et ne laisse aucune brèche à la lumière, au jour. C’est une vision vraie et sensible, mais qui frôle parfois un manichéisme tranchant et peu nuancé. Ainsi les séquences soulignent parfois à outrance l’obscurantisme de la pensée religieuse intégriste et enferment le spectateur dans une vision trop personnelle, trop individuelle.



C’est le défaut principal du film bercé par la bande-son de Gerard Pastor qui insuffle poésie et une certaine beauté à la trame. Anna Bofarull observe, puis montre que l’enseignement repose sur la violence, toujours la violence –les viols répétés, les armes, les combats- et il ne semble pas avoir de réponse pacifique possible. Obscurité. Obscurantisme. Monde claustrophobe. Les personnages sont présentés en gros plans ou en plans américains, ce qui semble leur ôter la liberté de mouvement, mais aussi celle du spectateur « enfermé » dans ces images. Dans un souci didactique compréhensible, la cinéaste guide le spectateur, mais aussi le dirige beaucoup, peut-être trop.



Le film reste une course à la liberté pour Hadia, l’esclave et Arjin afin d’échapper l’une et l’autre au poids archaïque représenté par des traditions moyenâgeuses (par exemple, le droit de cuissage qui justifie les viols du maître), mais en quoi la recherche de Marc par sa mère Carlota (Nora Navas propose une belle interprétation de mère déconcertée et perdue face à la décision de son fils) rejoint-elle la course à la liberté de Hadia et d’Arjin ? C’est une autre faiblesse du film qui n’a pas su ou pu établir un lien fort et substantiel entre les personnages. Ce lien pourrait être que chacune organise sa résistance, mais cette résistance se voit confrontée au sentiment de culpabilité que ressentent Hadia envers son fils Elias abandonné aux intégristes, Carlota qui n’a pas vu l’endoctrinement aveugle de Marc et Arjin envers son amie Samia. Mais une résistance se fonde-t-elle sur la culpabilité ?



Quelques séquences du film sont devenues malheureusement topiques aujourd’hui : le prosélytisme du maître, l’endoctrinement du jeune Elias, le viol programmé de Hessan. Toutefois, le film est nécessaire, car il montre que tradition et modernité se mêlent subversivement : ainsi le téléphone portable devient instrument de « guerre » entre la femme du maître et l’esclave. Paradoxe intégral. La cinéaste observe, montre, mais n’analyse pas les situations vécues par les personnages. C’est un film de constat qui n’apporte pas de réponse ou d’amorce de réponse alors que le monde occidental n’est pas innocent dans les situations de ces trois personnages. Mais il est juste de reconnaître que la cinéaste filme avec sincérité.



Le rôle omnipotent de la religion reste dans l’ombre, n’est pas mis en exergue si ce n’est au travers de scènes prévisibles et répétées, bien qu’elle envahisse tout le film avec ses mensonges et ses manipulations. Il est dommage que ce manque d’analyse entraîne des séquences peu émotionnelles, parfois peu crédibles à cause du manque de nuances dans le discours filmique. Le Bien et le Mal. C’est également un film sur la destruction, l’annihilation : que cherche Marc dans sa mort sacrificielle ? Que cherche Arjin en pointant son arme mortelle vers nous dans la dernière image ?



Oui, le film est cru lorsqu’il montre ces scènes perturbatrices, quoique vues et revues. Il n’y a aucun romantisme, car la religion ne l’est pas. Ici, elle n’est qu’oppression et semble remplir le vide social de nos sociétés, mais la société occidentale mérite-t-elle d’être annihilée ? Au nom de quoi ? De qui ? Précisément, l’intérêt du film est d’interpeller le spectateur qui le veut comme membre d’une société grâce au personnage de Carlota, mais la pensée occidentale permettra-t-elle d’accéder à la pensée de Hadia et d’Arjin ? Et si le spectateur ne veut pas être interpellé, ce film descriptif lui en donne aussi la possibilité.
Un film documentaire sur la lutte des femmes kurdes est sorti en 2022 et a été programmé au Festival du Film et Forum international sur les droits humains (FIFDH) de Genève en mars 2022. Il s’intitule Angels of Sinjar et sa réalisatrice est Hanna Polak.
Pour voir la version espagnole, cliquez ici.
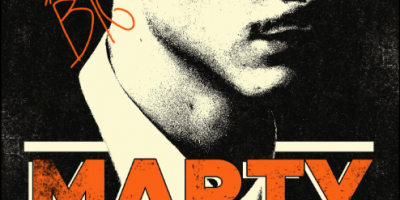


Dejar una respuesta