LA MAISON DANS LES CACTUS, película de Carlota González-Adrio, 2022
Critique de Véronique Gille
Durée: 88 min.
Année: 2022
Pays: Spagne
Réalisation: Carlota González-Adrio
Scénario: Paul Pen
Musique: Zeltia Montes
Photographie: Kiko de la Rica
Interprétation: Ariadna Gil, Daniel Grao, Ricardo Gómez, Zoe Arnao, Aina Picarolo, Anna Ruiz Solera, Carla Ruiz Solera, Judith Fernández, Marga Arnau
Genre: Thriller
Adaptation du roman éponyme de l’écrivain madrilène Paul Pen -d’ailleurs scénariste du film-, ce long métrage entraîne le spectateur dans la vie d’un couple, Rosa et Emilio, adeptes d’une vie marginale. Cinq filles aux noms de fleurs –Lis, Iris, Melissa, Dalia et Margarita– font de Rosa et Emilio des parents heureux. C’est une famille simple, besogneuse qui a tourné le dos à la civilisation et qui vit dans un cocon de tendresse, de complicité partagée… mais aussi de silence. Le spectateur comprend rapidement que les apparences sont trompeuses.
Ce monde attachant vit dans une ferme isolée et protégée par des cactus qui seront mortifères parce que ce monde est aussi tranquillement criminel. Les parents imposent à leur progéniture docile un mode de vie autarcique, proche de la nature: Rosa jardine et cuisine, Emilio vend les produits récoltés au marché du village et à son retour, il joue avec ses filles qui ne sont pas scolarisées. Mais ce qui paraît au début du film un hymne à la liberté, une ode à la nature, un mirage soixante-huitard rance ou une aspiration à la décroissance s’effondre à la mort de l’une des filles suite à un accident.



Ce parcours hors des normes de la société se fissure et ce qui apparaissait liberté se révèle carcan. Les colères d’Iris et les questions de Mélissa restent les meilleures représentations de cette nouvelle interprétation du film. Celui-ci prend alors une autre dimension: l’égoïsme pervers et criminel des parents est mis en lumière et leur psychorigidité se dévoile. Ils dirigent leur famille comme une matriarche et un patriarche sectaires et ne peuvent que soulever une inévitable résistance chez leurs filles adolescentes et le spectateur. Mélissa et Iris sont tiraillées entre l’amour voué à leurs parents et leur désir de vérité. Ce désir culmine dans les dernières scènes du film.
La cinéaste Carlota Gonzalez-Adrio montre avec des détails appuyés la tentative effrénée de Rosa et d’Emilio de se cacher et de se protéger derrière les apparences. Effectivement, le spectateur perçoit la lente montée de la paranoïa : Emilio l’exprime par des comportements violents, impulsifs qui suggèrent son incapacité à se remettre en cause, et de même Rosa adopte des expressions de visage inquiètes, mais n’en garde pas moins un visage inquiétant. La cinéaste nous tient en haleine dans cet affrontement psychologique grâce à une direction d’acteurs sans faille. Tous sont convaincants et atteignent pour certains (Daniel Grao, Ariadna Gil, Zoe Arnao) un naturel proche de l’improvisation.



C’est pourquoi le film semble embrasser dans ses débuts -sans que le spectateur ne sache vraiment pourquoi- la cause des protagonistes en les dépeignant comme des personnes instruites, attachées à des valeurs fortes et dont les principes moraux rigoureux sont paradoxalement ce qui les a amenés à commettre des crimes inexcusables. Précisément, la cinéaste trouve un équilibre entre un certain souffle romanesque, un léger lyrisme naïf et une sobriété qui ne fait pas sombrer le film dans le film à thèse indigeste, car la cinéaste élimine les apparences qu’elle nous a fait admettre et croire. C’est une famille où règne un dysfonctionnement symbolisé par des vitres fêlées, de la tôle froissée, symboles des mensonges que Rosa et Emilio entretiennent et transfèrent à leurs filles.
Cependant, la faiblesse du film réside dans l’approche ou, plus précisément, le manque d’approche du thème de la filiation. Une famille est-elle vraiment une famille juste parce qu’on choisit de la désigner et de la vivre ainsi, ou n’est-elle légitime que lorsqu’elle s’inscrit dans les registres civils et l’ADN? Le spectateur devine que ce qu’il regarde, c’est une fresque d’amour bancal, d’amour absolu, donc par essence malsain. C’est un amour fait de secrets. La vie déborde dans cette maison qui abrite et protège la tribu, mais cette maison-nid, à la fois protectrice et fragile, douillette et incommode, est construite sur le mensonge devenu normal et (presque) oublié par ses instigateurs. Vies bricolées -comme celle des jumelles que l’on doit éviter de voir ensemble-, mais étrangement solides.
La réalisatrice choisit d’accorder une attention particulière aux personnages très bien interprétés. Elle se tient proche de leurs visages, de leurs corps blessés, toutefois toujours à distance pudique. Elle filme le sérieux d’une maturité précoce (Iris, Mélissa), la douceur des peaux (Dalia, Margarita), les nuances psychologiques des visages et c’est pour cela que son film se divise en deux parties : le chaud et le froid. Le sain et le malsain. Deux sensations antagonistes, car face à la norme, à l’ordre des choses (représenté par l’institutrice Mila et Rafa), la justice de Rosa et Emilio n’a pas sa place et la morale non plus. Beaucoup de douleurs ne sont pas dites, parce que c’est mieux ainsi ou parce qu’autrement, ce serait tout simplement insupportable. Sans la surface volontiers souriante des repas animés et des échanges complices, Rosa et Emilio ne pourraient survivre. Mais certains aspects de la société espagnole des années soixante-dix échappent à la réalisatrice et c’est dommage.



Avec l’arrivée de Rafa, l’élément perturbateur, l’étranger venu de l’extérieur honni et terriblement craint, tout se casse. Les voitures brûlent, les pare-brises se cassent en mille morceaux, coupants comme des couteaux ou des épines des cactus. La cinéaste préfère les allusions et les remarques révélatrices aux explications. Rien n’est ce qu’il paraît être. C’est pourquoi la tension est constante entre les moments de bonheur et ceux de rage. En effet, Rafa compromet l’équilibre ambiant, car celui-ci a été créé artificiellement et illégitimement. Rafa est le fauteur de trouble qui apporte le désordre que craignent par-dessus tout Rosa et Emilio. Les premières images du film restent révélatrices : tableau d’un bonheur familial ordinaire (un père, sa fille sur fond de marché campagnard), harmonie initiale vite rompue par la tragédie, mais cette harmonie est rétablie quelques mois plus tard. Seul souvenir du drame, une croix plantée dans le jardin familial.
Tout est donc revenu à cet ordre établi quand fait irruption Rafa, inadmissible au sein de cet ordre inaltérable. Il va générer une rupture à l’improviste de l’ordre des choses. Rafa menace, inquiète par sa curiosité, son audace, son secret, mais avant tout parce qu’il est l’extérieur qui profane ce monde intérieur qui doit rester caché. Absolument. Son apparition noue une angoisse qui sera finalement résolue. Mais un instant perturbé par le surgissement de Rafa, l’ordre revient avec l’effacement du perturbateur. L’ordre retrouve ses apparences une deuxième fois et annule l’effondrement du couple… à moins que ce surgissement ait créé malgré tout un repos faussement inoffensif, signe que le danger semé par l’étranger et fortement troublant pour l’un des personnages est en attente de retour pour mieux lever le voile sur la vérité. La maison dans les cactus est un film qui reste. C’est le premier film d’une cinéaste à l’avenir prometteur.


Pour voir la version espagnole, cliquez aquí.


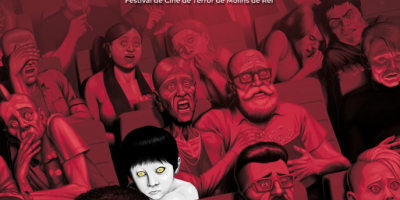
Dejar una respuesta