LE FROID QUI BRÛLE, un film de Santi Trullenque, 2022
Critique de Véronique Gille
Durée: 116 min.
Année: 2022
Pays: Espagne
Réalisation: Santi Trullenque
Scénario: Agustí Franch y Santi Trullenque
Musique: Francesc Gener
Photographie: Àlex Sans
Interprétation: Greta Fernández, Roger Casamajor, Pedro Casablanc, Adriá Collado, Daniel Horvath, Ksawery Szlenkier, Elisabet Terri, Nil Planes, Kasia Kapcia, Peter Nikolas, Albert Vilcan
Genre: Drame historique. Nazisme.
Peu de films et de musique laissent des images et des sons ancrés dans la mémoire de façon pérenne: malheureusement, le film de Santi Trullenque Le froid qui brûle n’en fera pas partie. On peut imaginer beaucoup de choses bonnes ou mauvaises sur le sens profond à donner au message -s’il y en a un- délivré par ce film, il n’en reste pas moins que c’est une œuvre inaboutie en raison de son impact psychologique et émotionnel peu crédible. Certes, elle pousse à la réflexion personnelle sur les divers thèmes traités, mais ceux-ci le sont superficiellement et ils s’entrelacent de manière plus que satellisée.
C’est un film sur la vengeance, familiale ou sociale, sur le caïnamisme, sur la folie et la barbarie, sur la violence et la cruauté. On pourrait penser que le réalisateur veut nous mettre en face de notre propre violence en situation de conflit et de guerre, mais très vite nous ne laissons pas piéger car les personnages, dans l’ensemble, sont caricaturaux. Ainsi l’image de Lars, l’officier nazi protagoniste, apparaît, alors qu’il est complètement nu et propre comme un sou neuf, dans un miroir. Miroir de la nostalgie aryenne parfaite. La beauté de son corps sera vite contredite par la folie du personnage, par la folie du nazisme: le sexe de Lars deviendra un instrument de guerre et de châtiment.
Ce film se définit comme un film historique, mais quand apparaît la conscience historique des personnages dans le film? Précisément, la caricature empêche toute dimension historique. En choisissant de mettre au premier plan une vendetta amoureuse comme toile de fond, la seconde guerre mondiale et le rôle des Andorrans dans celle-ci prend l’allure d’une guerre personnelle qui ne tourne pas autour d’idéaux politiques, mais autour d’un amour frustré et meurtrier. Santi Trullenque utilise le réalisme pour montrer une vérité brute et cruelle sur les aspects noirs de l’être humain, mais le sens collectif et donc historique du film se voit annihilé par le mélodrame.
Il aurait été pertinent et audacieux de montrer dans les séquences que la frontière andorrane a été synonyme de liberté pour ceux qui -Juifs, résistants ou aviateurs abattus rejoignant leur base- fuyaient le nazisme et la France de Vichy. Malheureusement, le film n’approfondit aucunement le beau rôle joué par ces Andorrans, membres ou non de la Résistance, passeurs qui ont sauvé des vies sur un territoire cerné de montagnes. C’est une frontière dont les Allemands deviendront les maîtres en 1942, d’où le personnage de Lars catapulté dans le village où il doit lutter contre les évasions tout en se mourant d’ennui jusqu’à en devenir fou (“Ici, il ne se passe jamais rien”, profère-t-il).
Il faut cependant saluer le travail d’Alex Sans, car la photographie est somptueusement belle et sublime des paysages pourtant angoissants et glaçants. Le film nous abreuve de feu, de froid se référant ainsi à l’oxymore du titre, de neige, de forêts mystérieuses, d’arbres tels des barreaux de prison et de sons métalliques tout aussi tranchants que la hache de Sara qui découpe un lapin. C’est un village de victimes sacrificielles, mais en même temps d’otages volontaires et de bourreaux, ce qui rend le film troublant. Il y a différents niveaux de lecture que l’on se situe du point de vue de la violence barbare de Lars ou des vengeances personnelles de Serafí, d’Antoni, de Joan et Sara.
On est tenté de cautionner surtout la vengeance de Sara, car mue par de “bonnes raisons”, sauf que finalement, les massacres perpétrés par les nazis et les massacres familiaux paraissent tout aussi importants et mis sur le même pied d’égalité. Cela est difficilement recevable dans le contexte historique. La cruauté peut engendrer la cruauté. Et cette cruauté est la même, qu’elle soit idéologique (dans le cas de Lars) ou rendue “morale” par des mobiles affectifs, donc acceptables selon la loi du Talion. Le spectateur peut ainsi éprouver une empathie pour le traumatisme inhumain vécu par Sara, un moment dévastée, mais sa réponse à la violence est tout aussi immorale que celle de Lars.
La vengeance de Sara la libère en tant qu’être humain pour ne pas rester une ombre. Les dernières images du film suggèrent à juste titre cette entrée dans la lumière du personnage et de son enfant, garant de sa survie. Mais elles jouent aussi sur la corde sensible comme le font aussi dans la construction du film les scènes de flashbacks qui sont nécessaires pour comprendre les mobiles psychologiques de vengeance de Serafí, de Joan et d’Antoni, cependant tout se révèle à une distance trop proche des personnages. La mise en scène est insuffisamment dosée entre émotion et distance, bien que les prestations des acteurs soient convaincantes. Tout est montré, rien ne nous est suggéré. Réalité brute et sans concessions des meurtres et du viol. Est-ce vraiment nécessaire? Cela le serait si le film était poignant et fort. Ce n’est pas le cas.




Toutefois, le personnage de Sara est intéressant (tout comme celui de Lars): sans véritable conscience politique, c’est le personnage qui évolue le plus. C’est une jeune femme, future mère, qui semble avoir toujours maîtrisé son univers fait de certitudes et de choix assumés. Son couple vole en éclats et elle vit un désordre intérieur qu’elle cherche constamment à recréer pour retrouver les certitudes qu’elle avait avant l’arrivée de la famille juive chez elle. Durant la guerre circulait en France une affiche propagandiste sur laquelle on lisait “la famille française est sauvegardée par le soldat allemand» et c’est précisément cette famille que Sara veut garder pour elle afin de rendre tangible cet univers mental qu’elle tient à reconstituer. Elle découpe un lapin, cuisine, prépare le petit-déjeuner, sert ses “hôtes” parce qu’il faut que la maison vive pour que tous survivent.

Le cinéaste la contemple de près tout en contemplant de loin la guerre qu’il laisse parfois pénétrer (et violer) dans certaines séquences filmiques -le son persistant des tambours pareils à des coups de canons et celui des cris gutturaux et bestiaux de Lars– par l’évocation systématique des Allemands qui envahissent un territoire sacré, celui de la famille, du foyer sous une atmosphère menaçante soulignée par la musique de Francesc Giner. Ces menaces sont annoncées par des prémices qui sont bien là: des disputes, des caresses voilées, des attitudes lâches… Autant d’indices qui renseignent sur le désordre mental d’une jeune femme cherchant à se raccrocher à ce qu’elle connaît et à refouler ce qu’elle craint.
L’espace de quelques plans sur la frontière et les paysages de neige ensoleillée loin du ténébrisme omniprésent des scènes d’intérieur, le film passe du drame à un possible espoir d’une vie à l’abri des dangers qui la guettent hors de la maison, dernier refuge. Les plans de fin du film balaient les combats, les meurtres, les séparations avec ce nouveau petit être qui représente (presque) le retour à une vie “normale”, se concrétisant par le regard de Sara lancé au spectateur. Elle a bravé la mort pour ressusciter. C’est un air de commencement dans un univers proche de l’enfer où l’Humanité a été mise entre parenthèses. La violence n’a pas de sexe ni d’âge et les rivalités viriles peuvent avoir des traits féminins.


Lars est un officier ivrogne à la férocité éthylique sans nom dont la tâche -surveiller la frontière pour endiguer les éventuelles évasions- le montre finalement comme le dindon d’une farce propagandiste. Fou et revêtu de ses atours sanglants et bestiaux, l’officier allemand est un animal, un automate décérébré viscéralement détestable tout comme l’abjection revêt le costume du docteur Coderch au service de la Mort. Il reste dommage que le réalisateur n’ait pas chaussé le ressort de l’humour pour produire cet effet de distanciation évoqué auparavant pour éviter que le film ne tombe dans un manichéisme crasse et dans les travers de l’outrance. Le film ne dresse aucunement un réquisitoire anti-nazi ou anti-guerre, car le mélodrame -récit des lâchetés et mesquineries de la nature humaine dans un jeu cruel de “dégommage” entre habitants du village- obère le tragique. Et la guerre: quelle belle saloperie!


Bien que quelques séquences du film relèvent du costumbrisme (la fête du village, l’assemblée des brodeuses et couturières digne d’un choeur de Lorca), d’autres font suffoquer le spectateur avec leurs visages ensanglantés, leurs traits déformés, filmés au plus près de la peur, de la barbarie et appuyés par une bande son omnipotente. On peut alors penser à l’œuvre de Ramon Sender Requiem pour un paysan espagnol et au film du disparu Mario Camus Les Saints Innocents. Malgré les invraisemblances psychologiques dans la construction des personnages et les pensées parfois simplificatrices sur les thèmes abordés, le cinéaste permet de faire entendre ce qui est inaudible: c’est en temps de guerre individuelle ou collective que l’être humain se surpasse, dans l’art de tuer et de survivre. En ce sens, lui aussi est un passeur, mais son film n’est pas un instrument de connaissance historique. Il reste dérangeant, problématique, manichéen… un film peut-être tout simplement vivant…
Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

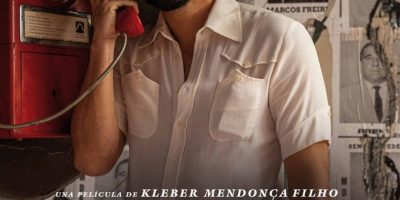
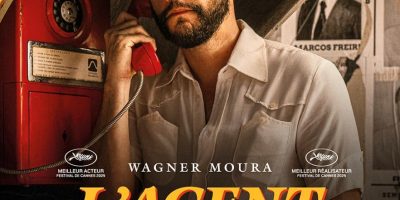







Dejar una respuesta