Film de Iciar Bollain, Espagne, 2024
Critique de Véronique GILLE
Réalisation: Iciar Bollain
Scénario: Iciar Bollain
Photographie: Gris Jordana
Musique: Xavi Font
Interprétation: Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Font García, Mabel Del Pozo, Pepo Suevos, Carlos Serrano, Mercedes Del Castillo
Pays: España
Durée: 110 minutos
Genre: Drame. Abus. Politique.
Le dernier film de Iciar Bollain est un film social qui dénonce avec justesse le harcèlement sexuel au travail. Oui, le harcèlement sexuel existe et on le rencontre vraiment dans ce long métrage. Il semble même que le droit de cuissage du Moyen-Âge soit toujours de mise aujourd’hui. C’est un drame oppressant que nous propose la cinéaste basque et qui nous fait sentir le souffle prédateur d’un potentat aux allures de caudillo d’Ancien Régime : le maire de Ponferrada, Ismael Alvarez. Le film est nettement engagé, inspiré d’événements vécus dans cette ville de Castille. Il décrit un fait de société qu’il dépasse pour s’immerger dans une expérience trouble et dangereuse bien servie par le talent des deux comédiens protagonistes : Mireia Oriol et Urko Olazabal.



Confusion et inquiétude que donne à ressentir la mise en scène s’entremêlent dans ce drame porté par les deux comédiens inspirés. Le suspense psychologique fait planer une tension constante et démontre des qualités cinématographiques qui n’hésitent aucunement à décrire les champs obscurs de la prédation ordinaire. La réalisatrice étire dans le temps les scènes pour faire affleurer le malaise et ce moment de bascule quand la lourdeur des mots ou des gestes côtoie l’insistance. Le film répond ainsi à ceux et celles qui pensent que les femmes victimes d’un supérieur hiérarchique doivent donner leur démission et ne pas se plaindre. C’est sa force, mais aussi sa limite de film à thème. Bien écrit, bien joué, bien filmé en longs plans séquences, il reste cependant centré sur le couple, abandonnant les autres personnages par la force des choses.



En revanche, le film établit un lien subtil entre le libéralisme prédateur d’un certain monde politique et l’outrage à la libre disposition de leur corps des femmes. La cinéaste veut rendre visible, parfois par touches trop appuyées, le mécanisme de la violence qui harcèle. Mais elle décrit avec sûreté et précision le jeu initié par ce prédateur soufflant le chaud et le froid et l’incapacité de sa victime à réagir au début. Il brouille les pistes. La bande-son, ponctuée de nombreux silences ou de grognements, instille un climat de tension parfois insoutenable et le malaise de Nevenka se transmet au spectateur instinctivement. Dès son arrivée à Ponferrada, les dés sont jetés puisqu’il est dit haut et fort que le maire, marié, puis veuf, n’est pas un modèle de vertu. Le harcèlement est insidieux : regards, silences, pauses ou tournures de phrases qui forcent la main, appels tardifs ou journées de travail allongées.



Le film sait exposer ce processus glaçant d’enfermement intérieur de Nevenka, pas à pas. Elle voit des choses promises se réaliser, elle est fière de son travail et se sent redevable. Alors le prédateur passe à l’acte, de sorte qu’elle se taira car elle ne comprendra pas et lui accordera le bénéfice du doute. Un léger dérapage. Mais il reviendra doucement et serrera l’étau à nouveau. Il sait que si Nevenka s’est tue la première fois, c’est que son isolement a commencé. Il la tient donc à sa merci. Le couple Urko Olazabal / Mireia Oriol ne se détraque jamais pour créer le malaise qui est au cœur du film : lui incarne l’homme parvenu, adoptant une gamme de comportements, autoritaire et serviable, amical et chasseur, portrait saisissant d’un univers masculin, malade de frustration sexuelle et de volonté de puissance qui laisse apparaître sa dépravation. Elle parvient à jouer l’incompréhension, le doute, la douleur, la terreur pénétrante : son émotion nous gagne, hurlant l’homme alors que la peur se transforme en colère et que son estomac, comme le nôtre, se sert. Tour à tour flattée et choquée, ses sentiments l’empêchent de tuer dans l’œuf le désir du chef. Et surgit alors une envie irrépressible de vomir, de crier.



La peur glisse progressivement vers la culpabilité, l’une des facéties concernant les victimes de harcèlement : toute victime d’agression devrait parler, et si cela survient trop tard, ça n’a pas eu lieu ou c’est sa faute. Pure mystification. Par moments la mise en scène fictionnelle est appesantie, à d’autres moments elle parvient à se faire oublier pour servir l’ambiguïté et la tension. Presque sans musique, le film enchaîne les scènes qui assoient la domination du prédateur : plans serrés sur les personnages souvent de dos ou de profil, ainsi le cadre ne s’ouvre pas et suggère le cloisonnement du pouvoir entre le dominant et la dominée. Le maire est en position de force, même lorsqu’il s’excuse, même quand il est absent. Mais le potentat n’est pas le seul responsable de cette déviance comportementale, c’est aussi une partie de la société, complice silencieuse et complaisante, qui génère ces abus.
Le corps de Nevenka, devenu public et les expressions de son visage illustrent sa répulsion, son refus, sa honte : elle ne s’apprête plus, elle ne se maquille plus, ne sort plus, couvre ses miroirs pour ne plus se voir, s’enfonce dans la solitude face à cette situation anxiogène qui la dépasse et l’a transformée en proie. Mais Nevenka est pugnace. Iciar Bollain se détourne de l’idéologie victimiste et emprunte une autre voie, celle de la délivrance. On saura peu de la plainte, des procédures judiciaires parce que le véritable enjeu est la libération de Nevenka qui devient une héroïne – celle qui réalise un exploit – en mettant fin à la tyrannie de son geôlier alors qu’elle aurait tout à perdre. Elle décide de changer les choses, pour elle et sa dignité. C’est en fait une jeune femme qui nous ressemble, à laquelle il est aisé de s’identifier.



Iciar Bollain semble dédier son film aux femmes anonymes, celles qu’on n’entend pas et qui n’osent pas parler en donnant la parole et une place à Nevenka Fernandez. Son film est essentiel dans l’ouverture de l’image que le public a des victimes de violence qui sont invitées à déculpabiliser et incitées à parler. Leur servitude désinhibée ouvre la voie à une lueur qu’il faut défendre tous ensemble. La chape de plomb saute dès lors que Nevenka réussit à faire aboutir sa plainte qui s’élève contre l’humiliante impunité machiste. Soy Nevenka pointe une société tiraillée collectivement et individuellement, mais une société qui avance, malgré tout, pour que ce machisme décomplexé aille au tapis et ne se change jamais en un cauchemar ordinaire pour les femmes. Au fait, qu’en pense Ismael Alvarez ?…







Première mondiale au Festival de Saint-Sébastien le dernier 21 septembre
Pour voir la version espagnole, cliquez ici.
Pour voir l’interview d’Urko Olazabal, cliquez ici.

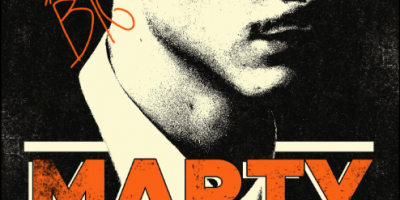


Dejar una respuesta