Film de Magnus VON BORN, Danemark, 2024
Critique de Véronique GILLE
Durée: 115 min.
Année: 2024
Pays: Danemark
Réalisation: Magnus von Horn
Scénario: Line Langebek Knudsen, Magnus von Horn
Musique: Frederikke Hoffmeier
Photographie: Michal Dymek (B&W)
Interprétation: Victoria Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri, Joachim Fjelstrup, Soren Saetter-Lassen, Tessa Hoder, Ava Knox Martin, Thomas Kirk, Dan Jakobsen, Anna Tulestedt, Ari Alexander, Benedikte Hansen,
Genre: Drame. Adoption. Maternité.
Un lieu. Nous sommes au Danemark à la fin de la Première Guerre mondiale. 1919. Nous sommes aussi, pour ce qui est du micro-territoire, dans la capitale, Copenhague dont les habitants sont là et essaient de survivre comme ils peuvent. Karoline est seule. Son mari, Peter, n’est pas rentré des champs de bataille. Où est-il ? Elle ne le sait pas. Elle sait seulement qu’elle doit se battre pour garder un logement dont le propriétaire la déloge sans ménagement, l’argent manque autant que la compassion pour elle, ce qui donne au film un arrière-plan sombre et impitoyable que le réalisateur assume pleinement. Voici un pays d’usines et de sols charbonneux. De sols charbonneux et de neige. Un film en noir et blanc.


Pour certains habitants, les rêves semblent inaccessibles. On est là, on vit mal, on s’y fait. Karoline s’y fait. Elle travaille dans une usine textile, durement. Elle attend le retour de ce mari absent. Certes, il rentrera au pays, mais avec la “gueule cassée”, victime de la boucherie guerrière. Karoline ne voudra plus de lui et sera plongée dans une autre histoire. Dans ce film, le gris est dans tous ses états, à la fois net et propre, mais aussi fondu, boueux, noir. Et il y a le froid, la fumée de l’usine, des cheminées, le brouillard et la vapeur des bains où Karoline rencontre Dagmar; cette vapeur, telle une fumée, qui enrobe les deux femmes dans un flou plein de doutes.


Dagmar se propose de résoudre le problème de Karoline qui accepte. Toutes deux vont entretenir une relation faite d’amitié, de rejet, de complicité, de mensonges. Elles se cherchent dans l’ambivalence. Une femme jeune résiste à écouter une femme mûre ; une femme mûre se risque à aider et conseiller une femme jeune. Les deux interprètes forcent dans certaines scènes leur jeu, mais souvent elles jouent juste. Dagmar tient une sorte de bureau d’adoption clandestin et aide ainsi d’autres femmes dans le besoin à placer leur enfant non désiré dans des familles mieux loties. Dans une logique extrême, Karoline s’associe à cette aide en s’attaquant à ce qui est aussi bien le désirable – l’enfant – que l’impensable – l’enfant -.


La caméra filme souvent en plans fixes pour mieux cerner les pensées de ces femmes prisonnières, prostituées, malades, folles tandis que les hommes sont abrutis ou malheureux, quand ils ne bénéficient pas de la ressource de l’autorité qui peut être maternelle. Cependant, la relation entre Karoline et Dagmar restera ce qu’elle a été depuis le début de l’histoire, floue. La soumission de l’une et de l’autre met en exergue la figure de Karoline qui souvent domine par son réalisme, sa juste intuition des rapports de force, ses solutions pour sortir de l’adversité. Elle pourrait même incarner la féminité et la rédemption, mais sort-elle victorieuse de ses combats lorsqu’elle adopte peut-être une meurtrière en herbe ?


Le film explore, du côté de la femme, la thématique du délit ou du crime commis par nécessité intime, soif de justice ou impossibilité de faire autrement (rappelons que le film s’inspire de faits réels), et dont le châtiment constitue une rédemption pour ces héroïnes déchirées et acculées. Le cinéaste évoque des schémas qui. à partir de l’enfance, structurent les adultes. Les hommes peuvent être rongés par la culpabilité et le tourment que les femmes contrecarrent comme elles peuvent en s’efforçant d’apporter des antidotes. Envisagée sous l’angle moral, la violence de Dagmar échappe à toute analyse politique car cette réalité brutale et complexe appelle le châtiment – éventuellement le pardon -, pas la justice. C’est pourquoi les spectateurs sont vite engloutis dans cet univers cruel, dans une époque impitoyable qui renvoie l’image de femmes passant en priorité par le prisme de la maternité et des sacrifices que l’on en attend sous le regard stoïque du réalisateur.


C’est la “beauté” de ce long métrage de rendre vivant cet univers mortifère. Quartiers boueux, spongieux, un enfer gris anthracite. Magnus von Born réussit un tour de force par son talent à filmer l’ignominie quotidienne, le malheur, la vie, le monde menaçant autour de Karoline qui a la nausée. Comme nous. Au milieu de ces vies, condamnées ou prédestinées au malheur, les deux femmes vont mêler leur destin à qui perd gagne. Karoline, la mère-enfant, emmitouflée dans les responsabilités, mais toujours vigilante et volontaire pour survivre, même lorsque la vérité éclatera dans un système hypocrite, putride et nécrophage. Le scénario casse d’ailleurs le maléfice à la fin du film en offrant une échappatoire, mais est-ce vraiment utile ?



Le film est réalisé avec un chromatisme photographique noir et blanc intensément contrasté et de nombreux gros plans, comme pour faire croire à un avenir radieux. Si on ne tremble pas lorsqu’une jeune femme, abandonnée et répudiée, se dispose à s’enfoncer une aiguille à tricoter dans le corps, c’est qu’on a le coeur infécond aux passions comme aux révoltes. Les dernières images du film avec la force symbolique de la décision de Karoline terminent une histoire qui a de ces ironies glaçantes, aussi glaçantes que le noir et blanc du film.

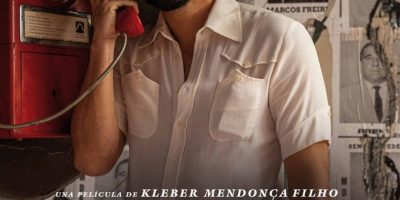
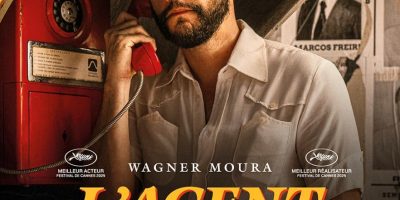

Dejar una respuesta