Lise Akoka, Romane Guéret, France, 2022
FESTIVAL D’A BARCELONA, 23 mars-2 avril 2023
Critique de Véronique Gille
Durée: 96 min.
Année: 2022
Pays: Francia
Réalisation: Lise Akoka, Romane Gueret
Scénario: Lise Akoka, Romane Gueret, Elénore Gurrey
Musique:
Photographie: Eric Dumont
Interprétation: Johan Heldenbergh, Matthias Jacquin, Loïc Pech, Mallory Wanecques, Dominique Frot, François Creton, Angélique Gernez, Esther Archambault, Timéo Mahaut, Carima Amarouche, Mélina Vanderplancke
Genre: Drame. Comédie. Cinéma dans le cinéma.
Les Pires est un film épouvantable. Non, ce n’est pas un film de terreur, mais il est terrifiant. Terrifiant de racolage et de démagogie. Terrifiant de voyeurisme et d’insanité. Certes, ce film à petits moyens a un propos sociopolitique brûlant: le quotidien des jeunes préadolescents et adolescents dans une cité –la cité Picasso– du Nord de la France. Un réalisateur a sollicité les pires de ces jeunes pour tourner un film. Ce long métrage est triste, si insupportablement triste malgré les sourires et les rires ébauchés par les interprètes qui jouent aux acteurs pour leur plus grand bien et notre plus grand mal. Mal. Malaise. Sans l’ombre d’un doute. Dilemmes et combats s’enchaînent à perte de vue devant le spectateur, rivé, cloué sur son siège face à de telles images parfois provoquées par les adultes eux-mêmes.
Mal. Malaise. Malsain. Qu’ils parlent, qu’ils répondent aux questions, qu’ils jouent, qu’ils se taisent, ces jeunes-là sont toujours en guerre. Guerre des mots, guerre des gestes, des mouvements, guerre des pensées, guerre des sentiments… à n’en plus finir. La caméra les regarde, les scrute et ne fait rien. Il est sûr que les éclats de réalité que le film traîne en son sillage éclaboussent notre quotidien confortable. Mais le spectateur doit-il se sentir responsable de cette réalité à chaque image? Il n’y a pas d’innocents. Bien sûr, il est su de tous que les adultes ne comprennent pas les adolescents, et vice versa. La même rengaine depuis la Grèce Antique.

Et pourtant, les cinéastes veulent arborer une palette d’émotions au travers de la lunette de leurs caméras, mais ce qu’il reste des prises de vue est la violence verbale et gestuelle, les insultes, le langage édifiant de pauvreté et le langage silencieux des sentiments. Sûrement, le film aurait pu être émouvant, incisif, voire subversif, perturbateur et plus encore, mais il n’est rien de tout cela malgré les nombreux thèmes qu’il survole : l’éducation présente et absente, l’identité, la culture ou l’inculture, l’intégration, les relations humaines, l’irrespect, le vivre ensemble… Le non désir de connaissances de ces jeunes élèvent un mur aussi haut que la mer. C’est ainsi que Gabriel, le réalisateur dans le film et dont le rôle est tenu inégalement par Johan Heldenbergh, se retrouve face à un quatuor constitué de deux filles, Lily et Maylis, et de deux garçons, Ryan et Jessy, des individus aux sensibilités épidermiques, paradoxales et abruptes.
Et rien ne marche, personne n’écoute. Il faut supposer que Lisa Akoka et Romane Guéret souhaitaient montrer des enfants tant en demande qu’ils en devenaient émouvants, doux et vulnérables, mais en fin de compte ils sont ennuyeux. Le film est donc une succession de cris, de crises, de tensions, d’incompréhensions, d’intrusions rejetées. Gabriel se heurte à une jeunesse à un avenir plus qu’incertain et apprend son intolérance, son ingratitude, ses di cultés -parfois insurmontables- de communication. Choc de la culture contre l’aculture, piège du dérapage dans lequel tombe le personnage-réalisateur à la fois opiniâtre, décontenancé, affecté et qui ne semble pas prendre la mesure du danger de rupture, car toute son attention se porte sur le seul fait de filmer son travail.

L’exclusion se vit des deux côtés de la caméra, car Gabriel se refuse à la résignation qui ne provoque que la violence chez Ryan et Jessy. Le tribut qui échoit au réalisateur et au spectateur est fait d’insultes homophobes, de rébellion perpétuelle et les dérapages inconscients (ou inconsciemment appris et retenus?) du langage se font étouffants. Le quatuor outrancier recrée le monde qu’ils abhorrent et brouille notre seuil de tolérance. Il n’est jamais réfréné dans ses accès de violence et de colère, au contraire, ils y sont parfois même encouragés. Les filles apostrophent d’autres filles, les garçons négocient encore la longueur de leur sexe… La honte de soi et le bagout des autres.
Les personnages connaissent-ils d’ailleurs le véritable sens des mots? Ou n’utilisent-ils que des mots gravés, entendus dans leur mémoire depuis leurs plus jeunes années sans que quiconque leur ait donné la signification exacte de ces mots? Les mots s’en vont alors en guerre et il s’agit de conquérir un pouvoir qu’ils ne peuvent pas avoir en dehors de la cité et d’avoir surtout le dernier mot. Les champs-contrechamps de la caméra qui filme, soit le réalisateur Gabriel, soit les jeunes dans une dynamique interactive, créent une tension forte et désagréable. Cette caméra s’engouffre avec les personnages dans le trou noir de leur quotidien. Mais bientôt le film se lézarde, car il se transforme en cinéma factice, forcé et monté de toutes pièces, un film où les séquences émettent des sons discordants.

ELe message du film est que la marginalisation et l’auto-marginalisation de ces jeunes perpétuellement en train de remettre en cause ce qu’on leur demande sont acceptées. Toutefois, un autre message se glisse en filigrane: notre bonne conscience, décente et engluée dans la culpabilité, a-t-elle besoin d’être ainsi sauvegardée? La réponse -sensible, touchante et réaliste- est peut-être donnée par les assistantes sociales qui œuvrent, fourmis ouvrières, pour tenter de reconstituer le tissu social déchiré de la cité. Les réalisatrices posent leur caméra, font répéter les acteurs, puis capturent sur le vif les images d’un pseudo cinéma-vérité afin de porter un message au spectateur, celui qui est avide de sensationnel, assis dans son fauteuil moelleux.
Mais ce qu’on voit, c’est un renoncement, une impuissance. Les larmes ne noient ni la violence, ni la colère et des questions restent posées: qu’advient-il de ces jeunes après, qu’advient-il des habitants de la cité Picasso après? Sommes-nous tous coupables? Changeons-nous tous en mal? Le film se garde bien de donner ne serait-ce qu’un début de réponse aux problèmes qu’il livre. Est-ce le rôle des cinéastes? Oui, quand ils -dans ce cas, elles- veulent dessiner les contours d’un cinéma social et politique. La dernière scène du film qui voudrait montrer l’irruption de l’émotion (enfin!) ne génère rien, nada. Aucune émotion ne s’envole, puisque tout ça, c’est du cinéma.

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.
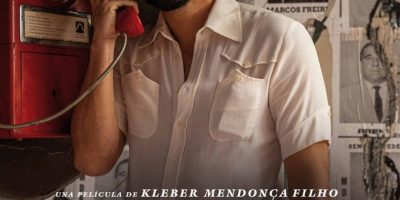
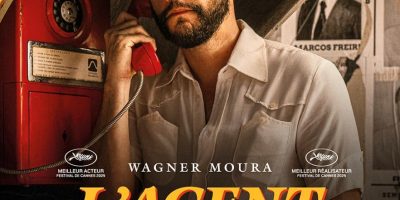

Dejar una respuesta