Film de Thomas LILTI, France, 2024
Critique de Véronique
Réalisation: Thomas Lilti
Scénario: Thomas Lilti
Photographie: Antoine Héberlé
Musique: Jonathan Morali
Interprétation: Vincent Lacoste, François Cluzet, Louise Bourgoin, Adèle Exarchopoulos, William Lebghil, Lucie Zhang, Bouli Lanners, Léo Chalié, Théo Navarro-Mussy, Mustapha Abourachid, Hubert Myon, …
Pays: Francia
Durée: 101 minutos
Genre: Comedie. Drame. Dramedia
“C’est une chance pour eux d’avoir un professeur”. Cette phrase prononcée par le directeur du collège où Benjamin débarque, jeune professeur de mathématiques suppléant, pourrait à elle seule résumer le film Un métier sérieux. Benjamin y découvre les problèmes récurrents de discipline, d’organisation administrative pesant sur le système scolaire, mais aussi la vitalité et l’humour de ses nouveaux collègues. Benjamin s’adapte et apprend. Parfois huis-clos tendu et nerveux, le film de Thomas Lilti a essayé de zigzaguer entre les clichés, nous faisant passer du sourire au questionnement, du désarroi à la réflexion. Le film est simple, souvent juste et généreux. On y voit une sincérité, une liberté, une efficacité qui pointent du doigt les dysfonctionnements d’une école parfois en perte de repères. Pourquoi est-ce l’élève qui prête son manuel au professeur ? Pourquoi le professeur débutant se forme-t-il en regardant des tutos sur youtube ? Pourquoi ne connaît-il pas les consignes à suivre lors du déclenchement d’une alerte attentat ? Et ainsi de suite.



Le film ausculte avec une certaine lucidité les origines de cette anxiété professionnelle qui mine certains professeurs. Entre comédie légère et séquences plus dramatiques, le film prend le spectateur à revers, car, au contraire du déjà mille fois raconté au cinéma sur l’école, le film se centre sur le récit d’une équipe de professeurs, unis pour le meilleur et pour le pire. Ici, l’élève est présent dans la réflexion ou les décisions des professeurs et apparaît rarement en tant que tel. Le scénario évapore les clichés, s’affranchit des comparaisons quelquefois peu flatteuses envers le milieu enseignant, car le cinéaste pose sa caméra à hauteur des professeurs pris dans une réalité qui côtoie souvent le dérisoire. De cette chronique aigre-douce sont également absents les parents qui, lorsqu’ils apparaissent, sont là sans y être. C’est pourquoi le film garde toute sa crédibilité et recèle des moments sympathiquement vécus ou non. Les professeurs spectateurs s’y reconnaîtront.



L’ensemble des acteurs – spécialement Louise Bourgoin (Sandrine), François Cluzet (Pierre), Vincent Lacoste (Benjamin) – font sérieusement leur métier et donnent leur ratio d’authenticité au film. Mais on regrette que celui-ci n’ait peut-être pas eu le cran d’évoquer les rivalités inhérentes à la profession (qui donc aura le diplôme le plus élevé et ainsi le droit de prendre une parole qui souvent sera retirée de la bouche des suppléants parce qu’ils sont seulement cela, suppléants ?) et autres mesquineries douloureuses dues à la hiérarchie jamais prouvée des matières – pourquoi une classe dont les élèves étudient l’allemand en première langue serait-elle “une bonne classe” ? -. Certes, le film retombe sur ses pattes, mais il reste incomplet, voire atteint d’angélisme car diverses réalités ont été éludées. Le problème de ce long-métrage est que presque tout y est simplifié, tant et si bien qu’on a l’impression, quoique passagère, que le réalisateur prend son public pour une classe à éduquer. Le film passe par beaucoup d’états, mais ne développe pas vraiment de point de vue.


Cependant, n’en déplaise aux partisans intransigeants de l’instruction exclusive, nostalgiques d’une école mythique, les rapports de force ne sont pas légitimés. Il ne s’agit pas ici d’un arrière-fond de vengeance ou d’un mépris de la jeunesse. C’est pourquoi le film convainc et montre plus d’espoir que d’appel à la révolte. Peut-être Thomas Lilti a-t-il compris que montrer une image juste de cet univers professoral sans l’améliorer ni la magnifier ferait évoluer les mentalités. Professeurs et élèves sont dépourvus de beaucoup de choses. D’où les mots et expressions parfois hurlés par les personnages : ces cris ne sont pas un point final ou une volonté d’avoir le dernier mot, mais une demande de réponse. C’est là l’intérêt de cette leçon d’école. Le réalisateur filme la parole en marche et met à nu les fractures de l’école, cette école qui en demande toujours plus aux professeurs. C’est pourquoi les plans rapprochés, voire les premiers plans ne cessent de se succéder.
Aujourd’hui ne sont-ils pas psychologues, assistants sociaux, parents de substitution, agents de voyage, guides touristiques, secrétaires, secouristes ?… Il est alors normal que le film soit un plaidoyer pour le droit à l’erreur, à la faiblesse, par exemple face à une inspectrice qui constate, mais ne propose aucune vraie solution. Thomas Lilti réussit l’alliance de la lucidité et de l’espoir. Il débusque les problèmes et met en valeur les élans et les sursauts qu’ils déclenchent chez les personnages. Il crée un film qui multiplie les effets de réel avec une accumulation des petits faits vrais en privilégiant les séquences caméra sur épaule, d’où parfois l’effet documentaire avec ses images qui s’agitent. On peut partager avec le metteur en scène l’intégralité du diagnostic dont le fonctionnement du système scolaire serait une caisse de résonance, toutefois il reste difficile d’adhérer au traitement cinématographique qui ne lorgne pas sur l’esthétique. De même, certains personnages sont pauvres dans leur densité fictionnelle et chaque situation de contrariété engendre une réaction qu’on anticipe.



Le film juxtapose des saynètes (pas toujours originales) qui racontent l’enseignement, la transmission, la solidarité, le corporatisme, le mal-être, parfois l’impuissance de ces professeurs au milieu d’enjeux sentimentaux et familiaux convenus qui ne mobilisent pas l’attention malgré les réflexions existentielles qui les jalonnent. Les défauts du film avec ses situations et personnages conventionnels sont toutefois rattrapés par ses qualités : des acteurs concernés et convaincants, une démagogie parfois heureusement évitée. Force est de reconnaître pourtant que, d’abord buissonnier, le film endosse vite l’uniforme du film de professeur et égrène ses séquences comme des sujets de cours, au lieu de prendre une seule intrigue et de la dérouler. Le film avance, teinté par une belle palette de sentiments qui jouent sur des touches d’émotion et d’humour, sans trop forcer le trait et il ne sombre pas dans le mélo tire-larmes ni le pamphlet politico-social. C’est bien comme leçon d’humanisme, mais trop scolaire en termes cinématographiques.
Le système ne va pas très bien et n’est pas simple, mais personne ne baisse les bras – exceptés parents et élèves – et Thomas Lilti construit une atmosphère qui gomme le didactisme pour privilégier le portrait en injectant au récit un caractère dont la vertu est d’exprimer l’énergie et l’élan qui habitent les personnages. Pour lui, il ne s’agit pas de ridiculiser le métier d’enseignant. Son projet est de montrer une vision de l’école, ainsi que la nécessaire passion qu’il faut aux professeurs pour assumer leur métier, souvent réduit à des clichés. En ce sens, le réalisateur fait honneur à ces professeurs aux nobles combats. Le choix scénaristique le pousse à dresser des portraits assez caricaturaux avec une narration sans grande surprise, mais on doit reconnaître avec honnêteté que la fiction fonctionne bien. Il y a de la dignité dans la façon de filmer les personnages.



Le film peut séduire précisément par les portraits qu’ils proposent tels ceux de Benjamin et de Pierre. Sans tarder, le professeur novice prend plaisir à enseigner malgré les situations compliquées qu’il rencontre, notamment avec Enzo, élève rebelle et victime. Benjamin apprend à ne pas se cacher devant l’échec, honteux et isolé, et écoute ses collègues engagés à l’aider. Un autre portrait est celui de Pierre : autorité, fermeté, savoir et pouvoir se conjuguent chez lui. Un homme un peu usé par son métier dans lequel il pense que tout est acquis. Son attitude éteinte déteint sur ses élèves qu’il ennuie tandis que défilent des figures plus séduisantes de professeurs – Meryem, Fouad, Sofiane – à travers leurs cours enjoués. Pourtant, Pierre ne manque pas d’humanité, mais il manque de force pour surmonter ses propres échecs que lui renvoie aussi son foyer. D’ailleurs les procédés narratifs du film et sa mise en scène n’ont de cesse de souligner l’isolement auquel il se condamne dans l’échelle de plan et la profondeur de champ. Les champs/contrechamps sont lourds de sens, le filmant souvent seul face à une entité collective. Mais des motifs d’espoir sont amorcés avec la manière dont le bousculent Fouad et Simon (un élève apparemment studieux qui préfère lire La promesse de l’aube de Romain Gary que L’Assommoir de l’incontournable Zola). Grâce à ces “bousculades” émergent enfin les sentiments de Pierre avec le souci de la vraisemblance dans le jeu des comédiens, premiers de la classe.
Bien sûr, le film n’a pas toute la profondeur attendue, mais il faudrait être bien sévère pour ne pas y trouver un petit bout de bonheur. Celui d’enseigner. Un métier sérieux laisse croire que les professeurs partagent leur savoir avec l’étincelle indispensable à leur métier généreux et courageux, ouvrant l’accès à une compréhension du monde qui déborde parfois les murs étroits de l’école. C’est une vérité. Oui, le film peut redonner du baume au cœur avant la rentrée des classes. Dans tous les cas, pour la rentrée, on aimerait être dans la classe de ces professeurs.
Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

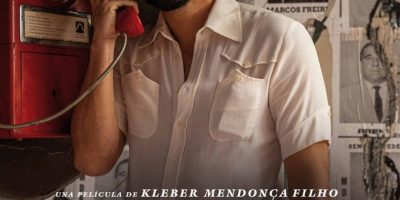
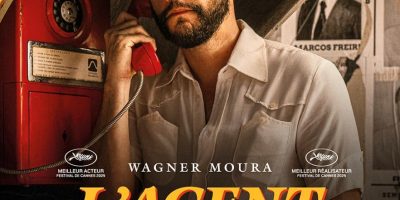

Dejar una respuesta