Film de Tim MIELANTS, Belgique, Irlande, 2024
Critique de Véronique GILLE
Durée: 96 min.
Année: 2024
Pays: Irlanda
Cine actual: estrenos, recomendaciones y festivales.
BCN FILM FEST, Drama, Familia, Religión
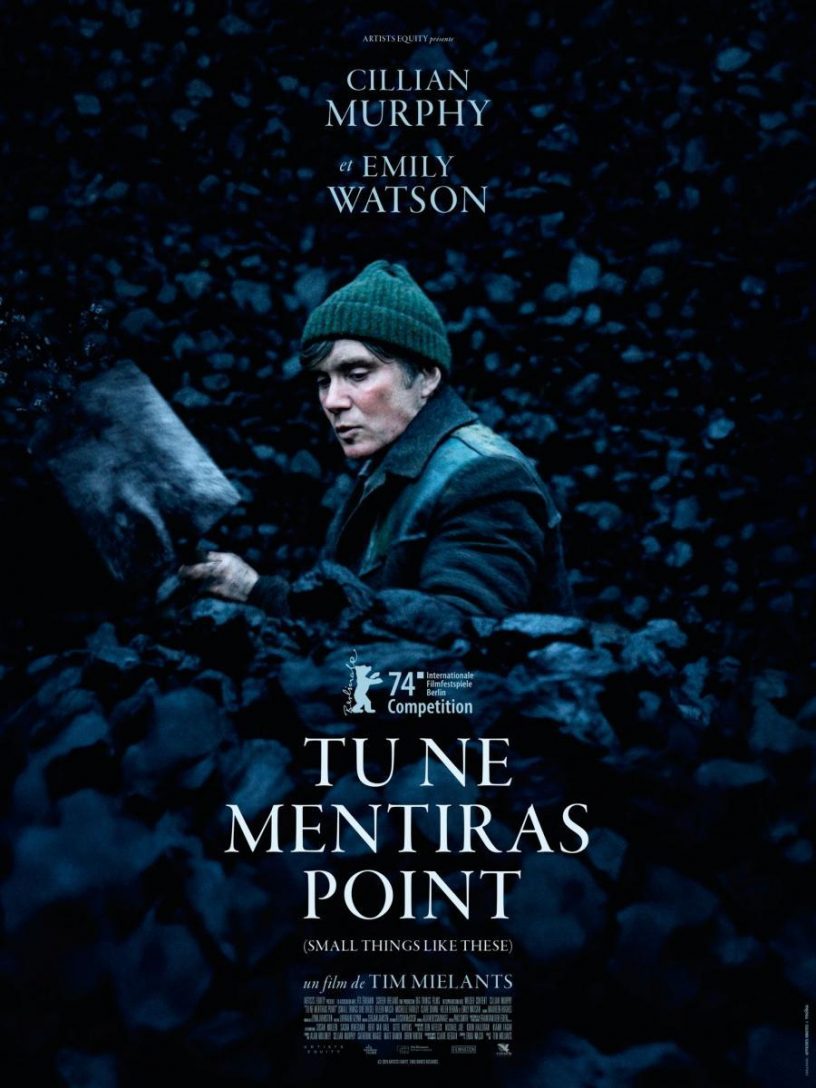
Film de Tim MIELANTS, Belgique, Irlande, 2024
Critique de Véronique GILLE
Durée: 96 min.
Année: 2024
Pays: Irlanda